Nous avons lu pour vous
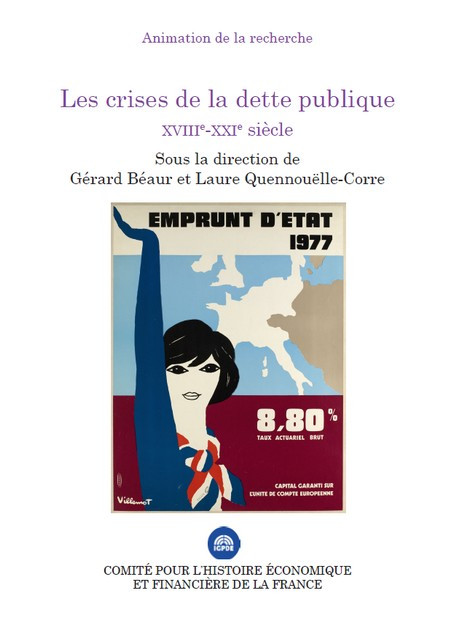
Un premier livre sur « La dette publique dans l’histoire » avait été publié par le CHEFF en 2006. Celui-ci présente les nouveaux travaux de 21 historiens réunis dans un séminaire de plus de deux ans, couvrant l’histoire de la dette publique dans huit pays pendant trois siècles. Ces analyses et réflexions sont souvent d’une grande actualité et plusieurs articles se réfèrent d’ailleurs aux travaux controversés de Carmen A. Reinhart et Kenneth S.Rogoff sur les liens entre dette publique et croissance. L’impression d’ensemble est que le phénomène de la progression de l’endettement des États est général depuis le XVIIIe siècle. Si l’origine du surendettement des États se trouve bien souvent dans les exigences du financement des guerres, la mauvaise gestion y a sa part. Le mauvais exemple est celui du règne de Louis XIV. L’histoire montre aussi que, dès le XVIIIe siècle, la dette devient un formidable outil de développement des États pré-capitalistes et pré-industriels (la Grande-Bretagne au milieu du XVIIIe siècle, la Russie un peu plus tard), par la modernisation du système bancaire et financier d’abord, puis par l’expansion de l’économie tout entière et même de la société politique comme le montrent les exemples de la gestion de la dette de la guerre de Sécession par l’État fédéral américain ou le débat sur la résorption de l’endettement des années 1970 en Allemagne.
Les dangers de la dette n’en sont pas moins réels : la banqueroute et son cortège de misères et de dépendance et, plus concrètement, la réduction des marges de manœuvre budgétaires due au poids de la charge annuelle des intérêts : en France, en 1787, les dépenses civiles représentent 22 % des ressources, les dépenses militaires 27 % et le service de la dette 51 % !
Mais, il semble que le problème principal de la dette n’est, ni celui de son montant, ni celui de son remboursement mais celui de sa « gestion ». L’art de gérer la dette peut, parfois, être de faire accepter le défaut partiel (la France y a beaucoup recouru sous la Régence et la Révolution jusqu’à la fameuse banqueroute des deux tiers en 1797, à l’inverse de la Grande-Bretagne qui a su restructurer sa dette sans crise tout au long du XVIIIe siècle). Il repose le plus souvent sur les modalités les plus diverses pour faire « rouler » la dette, la convertir, la reporter sur d’autres débiteurs, l’éroder par l’inflation afin poursuivre la course vers la transformation d’une recette immédiate et réelle en dépense future et éventuelle. Il faut bien constater que les méthodes orthodoxes de l’austérité et de la pression fiscale, si elles ne sont pas exclues (par exemple avec la création des vingtièmes par Machaut d’Arnouville au milieu de XVIIIe siècle), ne sont pas des plus répandues.
L’histoire révèle quelques héros vertueux (le contrôleur général des finances Nicolas Desmaretz après la guerre de succession d’Espagne à la fin du règne de Louis XIV ; Lord Pelham au milieu du XVIIIe siècle ; le conseiller du tsar Speransky au début du XIXe siècle) et quelques entreprises malhonnêtes (la banque de Law et, à la même époque, la Compagnie des mers du Sud en Grande-Bretagne) aux conséquences désastreuses. Or, si personne n’a pu encore déterminer la limite d’endettement à ne pas franchir, toutes les expériences convergent sur l’idée commune que la clé d’une bonne gestion est le maintien ou le rétablissement de la confiance dans la solidité de l’État emprunteur. Il est bon que, au moment où les doctrines les mieux établies en matière de finances publiques se troublent (Voir le dossier sur la gestion de la dette dans ce numéro), les historiens s’intéressent à la dette publique et que le regard des historiens intéresse les financiers. ■

C’est un livre ambitieux au service d’un grand projet, qui rejoint le thème de notre colloque du centenaire ; c’est un livre éclairant pour tous ceux qui se sont intéressés à la monnaie comme un sujet accessoire et trop complexe pour entrer dans les détails ; c’est un livre dérangeant pour tous ceux qui se sont contentés de la vulgate orthodoxe tout en ayant l’intuition qu’on pourrait faire autrement.
Dans un premier temps, ce livre éclaire sur la vraie nature de la monnaie et soulève le voile sur les mécanismes du système monétaire ; dans un second temps, il expose comment une politique monétaire « active » pourrait permettre de financer la transition écologique sans augmenter la dette.
L’ouvrage apporte d’abord d’utiles rappels sur le fonctionnement actuel du système monétaire. La monnaie est définie comme « une institution sociale qui tire sa force et son utilité de la confiance de la collectivité qui l’emploie ». L’évolution depuis les années 1970 est marquée par une dématérialisation croissante de la monnaie qui va de pair avec une accumulation sans précédent de dettes publiques et privées. Il faut bien constater que cette explosion de la création monétaire n’a guère profité à l’économie réelle. La raison en serait, selon les auteurs, que l’essentiel des flux ont été absorbés par l’augmentation du prix des actifs financiers et immobiliers, c’est-à-dire par la spéculation. Cette évolution n’est guère maîtrisée. En effet, la monnaie est principalement créée par les banques commerciales « à partir de rien », en accordant des prêts et en achetant des actifs financiers. L’action des banques centrales est limitée de multiples façons : les instruments de politique monétaire ont tous été démantelés depuis les années soixante-dix (en France, les avances de la Banque de France à l’État et le circuit du trésor). La variation des taux d’intérêt est un instrument frustre et indifférencié, devenu inopérant avec les taux durablement très bas. Les dogmes de l’objectif exclusif de limitation de l’inflation, de neutralité monétaire, d’indépendance des banques centrales et d’interdiction de financement des États limitent l’action des banques centrales même si elles sont élargi leur capacité d’intervention ; elles n’interviennent pas directement sur l’économie mais toujours par l’intermédiaire des banques commerciales. Les prévisions des orthodoxes sur les conséquences de cet afflux de création monétaire ne se sont pas réalisées : la hausse considérable de l’endettement ne s’est pas accompagnée d’une hausse de l’inflation, ni des taux d’intérêt. Or, selon les auteurs, l’expansion monétaire et une certaine dose d’inflation ne sont pas mauvaises en soi et peuvent avoir des effets très positifs sur l’activité. En témoignent quelques exemples de politiques monétaires expansionnistes réussies : la reconstruction économique de l’Allemagne (1920-1939), le New Deal américain ; la reconstruction en France ; la politique monétaire expansionniste en Chine.
Or, la transition écologique demande une mobilisation considérable de financements. La Cour des comptes européennes estime le besoin à 1 115 Md€ par an dont 75 Md€ en France. Les systèmes actuels sont très loin de fournir la réponse alors que le marché montre son impuissance à dépasser les critères de rentabilité et que les énergies fossiles sont encore plus aidées que les énergies renouvelables. Pour les auteurs, la mobilisation de la politique monétaire permettrait de couvrir ces besoins à condition de revoir nos conceptions de la monnaie, de la dette et du taux d’intérêt.
La seconde partie du livre préconise une série d’orientations radicalement nouvelles poussant jusqu’à l’utopie mais dont l’avenir est certain puisque nous voyons déjà ces idées faire leur chemin chez les économistes et dans les discours les plus avancés des responsables de l’Union européenne ou de la BCE. La première orientation relève de la politique budgétaire des États qui peut être facilitée par une politique monétaire « active ». Les États devraient profiter des taux bas pour s’endetter encore plus et investir massivement dans la transition écologique. Pour les auteurs « le meilleur moyen de résorber la dette est d’investir et de stimuler l’activité ». Les investissements dans la transition écologique pourraient être amortis sur plusieurs années dans les budgets et pour le calcul des déficits. La seconde orientation est l’annulation de tout ou partie des dettes publiques par la Banque centrale européenne, ce qui libèrerait un flux financier considérable pour les investissements verts. Pour les auteurs, les traités européens pourraient être interprétés et modifiés à la marge pour arriver à ce résultat. Les autres objections économiques sont réfutées : la banque centrale peut accumuler des pertes, les États n’ont aucune obligation de la recapitaliser, on a connu des banques centrales fonctionnant avec des capitaux propres négatifs.
Mais les auteurs vont plus loin. « Entre la neutralité monétaire et la neutralité carbone, il faut choisir ».Ils proposent de réintroduire des critères politiques dans la conduite de la politique monétaire en abandonnant l’objectif exclusif de lutte conte l’inflation (ce que permet l’art.119 du TFUE) et le dogme de la neutralité monétaire. Les banques centrales devraient pouvoir différencier les critères d’acceptation des « collatéraux » présentés au refinancement ou même les taux d’intérêt servis aux banques en appliquant un critère environnemental pénalisant les actifs bruns et favorisant les actifs verts. Les banques commerciales répercuteraient rapidement ces incitations à l’économie. Allant plus loin les auteurs proposent d’autoriser les banques centrales à acheter des actions directement dès leur émission, notamment des titres émis par les banques publiques d’investissement, telles que la BEI ou BPI France. Ces institutions interviendraient beaucoup plus massivement qu’aujourd’hui dans le financement de la transition écologique (le régime des aides d’État étant adapté) et émettraient des obligations à très longues durées et à taux très faibles qui seraient immédiatement achetées par la BCE. « Ainsi on aurait accès à une manne illimitée pour financer la transition écologique ».
S’autorisant de la doctrine nouvelle de Modern Monetary theory (proposée par exemple par le fonds d’investissement Black Rock en juin 2019 au sommet de Jackson Hole), les auteurs dessinent les contours d’une « monnaie libre », c’est-à-dire créée sans accumulation de dettes et sans limites , gérée comme un bien commun (au sens des travaux d’Eleonor Ostrom), par une banque centrale unique et non indépendante, qui se passerait de l’intermédiation des banques commerciales, assistée par un « parlement de la création monétaire » et qui accorderait des crédits directement aux acteurs économiques (États, entreprises, ménages) pour financer la transition écologique. Les auteurs concluent sur la perspective d’une « monnaie verte internationale » qui aplanirait les écarts entre États.
Même si ces perspectives susciteront des réserves, on ne peut que partager leur souhait de faire de la monnaie, aujourd’hui instrument de reproduction des inégalités économique et sociales, « un formidable outil d’émancipation et d’action ». ■


