Nous avons lu pour vous

Deux chercheurs reconnus et expérimentés en histoire économique et financière, Michel Margairaz et Fabien Cardoni, proposent de combiner une analyse de l’état des finances et des finances de l’État dans le cadre d’une chronique d’un long XXe siècle. Pour mener à bien ce projet titanesque, ils ont invité différents auteurs qui bénéficient tous de la reconnaissance (dans les deux sens du terme) de la communauté scientifique pour leurs travaux. L’idée bien comprise est de saisir l’objet finances publiques dans une perspective chronologique longue et à travers différents axes confiés chacun à un spécialiste (l’économie, la dette, le contrôle parlementaire, la programmation, les administrations de statistiques, les indemnités et dommages de guerre, la construction européenne ainsi que deux analyses sectorielles). Il reste évidemment d’autres axes à explorer, et personne ne songe à le nier (le droit public financier, la comptabilité publique, les agents publics, les contrôles autres que parlementaires, la fiscalité etc.). Néanmoins ce choix offre un grand mérite, il lance le chantier et ne cherche absolument pas à en dissimuler l’ampleur. Ce choix présente encore un intérêt puisque l’approche thématique permet d’éviter le côté artificiel du découpage d’une monographie ou le fractionnement des encyclopédies et apporte une réponse pertinente à une question récurrente : comment aborder les finances publiques dans une perspective longue ? Sur ce point, l’ouvrage est à la fois très convaincant et très agréable à lire.
Les regards thématiques pourraient aussi conduire à une impression de superposition. Mais ce n’est pas le cas, car chaque chapitre renouvelle les découpages et le bornage chronologique de la période considérée. C’est un intérêt indiscutable de cet ouvrage que de permettre d’observer différentes façons de découper le XXe siècle, à travers différents regards sur cet État des finances publiques. Si les guerres mondiales sont importantes, le passage à l’euro ne trouve pas le même écho quand on évoque la dette et la construction européenne d’une part, ou la programmation financière et la Culture d’autre part. Il en va de même du bornage chronologique qui varie selon les thèmes. Le XXe siècle peut ainsi débuter bien avant la IIIe République, dans les années 1880 ou en 1945 (pour la construction européenne). Il se terminera souvent de nos jours, mais pas forcément. Si on en doutait, on trouve ici une illustration de ce que l’histoire des finances publiques n’est pas monolithique.
Un autre point intéressant, au niveau méthodologique, résulte de ce que les chapitres de cet ouvrage sont principalement, mais pas exclusivement, confiés à des historiens. Il est éclairant de lire ces collègues sur les périodes les plus récentes, et d’observer l’évolution des sources qu’ils mobilisent. L’histoire devient moteur de l’interdisciplinarité et cela s’exprime aussi à travers les différentes nuances disciplinaires qui sont mobilisées (histoire économique, histoire de l’administration, histoire institutionnelle, histoire des techniques etc.). Il faut encore préciser que les deux études sectorielles portant sur la Culture et l’Éducation viennent très habilement clore l’ouvrage. Elles sont toutes les deux passionnantes.
Enfin on sent, à la lecture, que le découpage de l’ouvrage traduit une intention claire de direction scientifique exprimée par le sous-titre comprendre les dynamiques du long XXe siècle. Chaque auteur, mobilisé sur son « pôle de spécialité », s’est approprié son thème et un grand nombre y a collé autant qu’à la perspective financière. Il serait très injuste, et certainement un peu pédant, de décerner des bons points à l’occasion d’un travail collectif qui constitue bel et bien un ensemble. Que l’on me permette d’insister sur le chapitre rédigé par Clémence Cardon-Quint, qui propose une fresque très complète sur la relation entre finances publiques et Éducation. On y lit à la fois les éléments structurant la réforme de l’État (fonction publique, organisations administrative et financière), les grandes évolutions politiques et institutionnelles, ainsi que les préoccupations des différentes administrations impliquées entre 1870 et nos jours. Si on ne devait retenir qu’une raison de lire cet ouvrage, ce serait de le terminer par ce chapitre. ■ Sébastien Kott

Les études historiques ou sectorielles sont indispensables pour bien comprendre les techniques actuelles du droit public financier. L’ouvrage de Fabien Cardoni en apporte une preuve éclatante. Le chercheur au laboratoire « Institutions et dynamiques économiques de la société » (CNRS-Paris 1) entreprend ici l’étude, à la fois historique et sectorielle, des lois de programme militaires entre 1960 et 1970 en croisant les regards de l’historien, du juriste, du politiste, de l’économiste, du financier, du sociologue… Cet ouvrage rigoureux et extrêmement bien documenté se lit d’un trait et apporte de nombreux éclairages sur les mécanismes budgétaires actuels, vues originales ou illustration pertinente de phénomènes connus.
L’étude a pour cadre la mutation profonde des armées françaises avec l’échec de la Communauté européenne de défense (CED), la fin de la guerre d’Algérie, la volonté d’indépendance par rapport à l’OTAN et, surtout, la création de la force de frappe nucléaire française, très consommatrice de crédits sur de longues périodes. Les trois lois de programme étudiées (1960-1964 ; 1965-1970 ; 1971- 1975) ont pour objet principal d’organiser cette mutation. Mais l’auteur démontre que le contrôle de la trajectoire d’évolution des moyens a constamment prévalu sur les orientations stratégiques.
Pour prendre quelques exemples parmi de nombreux autres, le lecteur pourra s’intéresser à la production des chiffres budgétaires, aux causes de l’échec de la rationalisation des choix budgétaires, au double jeu de la direction du budget ou aux limites de la programmation pluriannuelle.
On s’intéresse plus souvent aux chiffres eux-mêmes qu’à leur production. Or, derrière l’apparence de rationalité et d’objectivité se cachent d’intenses luttes de pouvoir. En l’occurrence les jeux d’acteurs sont soigneusement décortiqués. Chez les militaires : les états-majors des trois armes, l’état-major général des armées, la délégation ministérielle pour l’armement, le secrétariat général pour l’administration des armées et sa direction des services financiers, le cabinet du ministre, le ministre des armées (Michel Debré puis Pierre Messmer) ; côté civil : le commissariat général au Plan, le service des études économiques et financières (SEEF) qui devient la direction de la prévision, la direction du budget ; au-dessus de la mêlée, le chef de l’État qui a le dernier mot sur les orientations du « gaullisme militaire ». Mais le politique est-il conscient qu’il décide et arbitre sur la base de chiffres obtenus par des méthodologies douteuses et diverses, après des négociations entre acteurs aux intérêts et aux visions divergentes et à l’issue d’une cascade d’arbitrages aux finalités confuses ? En 1964, un nouvel acteur, le Centre de prospective et d’évaluation, obtiendra un quasi-monopole des études prospectives, techniques et stratégiques. Malgré le soutien du ministre, les ambitions d’une rationalité dégagée des contraintes corporatives ou politiques se heurteront à la résistance des autres acteurs et ne changeront guère les modes de préparation (« à tâtons ») ou d’exécution (« à reculons ») de la loi de programmation. En définitive, « la programmation produit des chiffres manipulables à l’envi ; les chiffres des lois de programme font partie d’un message politique à l’intention des puissances extérieures, des citoyens contribuables et, enfin, des militaires français ».
La tentative de renouveler les méthodes de programmation par le 3PB (planification, programmation, préparation du budget) entre 1966 et 1969, inspirée directement du PPBS américain aboutit à un échec. Les causes en sont communes avec la RCB civile, contemporaine et de même inspiration : une ambition excessive, un projet détaché de son contexte, une réforme imposée d’en haut, une sous-estimation des facteurs humains, un portage politique fort au début et évanescent ensuite, la résistance opiniâtre « d’une coalition formée des industriels de l’armement, de la délégation ministérielle pour l’armement, de la direction des services financiers, de l’état-major des armées, des états-majors ». Cet effort marque le début des essais d’introduction des méthodes de gestion privée à la Défense, l’émergence d’une culture de la performance, ainsi que l’adoption de techniques nouvelles : calculs coûts-efficacité et budgets de programme, mais le 3PB sera assez rapidement abandonné et la programmation conservera son caractère « irrationnel ».
La cause principale de l’échec de la programmation militaire est la stratégie constante de la direction du budget qui n’a jamais cédé sur le principe de l’annualité budgétaire. Encore aujourd’hui, les lois de finances annuelles ont seules force normative et peuvent remettre en cause les prévisions des lois de programme ou de programmation. Pour le budget, la finalité principale de la programmation est de contenir la progression des dépenses militaires. L’ouvrage expose les multiples techniques mises au service de cet objectif : plafonnement annuel des dépenses, mesure de l’évolution des dépenses par un rapport du budget militaire au budget total de l’État, au revenu national ou au PIB (en francs courants le budget militaire passe de 14 à 35 Mds entre 1958 et 1973, mais la part des dépenses militaires dans le budget de l’État est réduite de moitié en vingt ans de 36 % en 1952 à 18 % en 1972, le budget militaire représente 6,4 % du PIB en 1960 et 3,7 % en 1974) ; élargissement du domaine couvert par les lois de programmation; compensation du financement de l’arme nucléaire par la réduction des crédits de matériels conventionnels et de personnel ; sous estimation de « l’inflation militaire » et des dépassements de coût des programmes à l’intérieur des enveloppes fixées ; ajustements conjoncturels. Même si de telles exigences choquent les militaires, l’auteur remarque que l’édification de la force nucléaire a été effectivement financée et pour un coût raisonnable, estimé à 40 Mds entre 1960 et 1970. Pour lui, « la force nucléaire a coûté cher aux armées mais assez peu à la Nation ».
Ce constat conduit à repenser la fonction de la programmation. Ce n’est certainement pas, comme on pourrait le croire en se fiant au texte de l’article 34 de la Constitution, la fixation des « objectifs de l’action de l’État » et des « orientations pluriannuelles des finances publiques » ou, comme le souhaitaient les militaires, un engagement pluriannuel sur l’augmentation des moyens nécessaires à la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par l’exécutif et le Parlement. En ce sens, les lois de programme sont un échec : « préparées avec difficultés et exécutées dans la douleur, les lois de programme ne peuvent qu’aboutir à des résultats décevants ». En fait, « le Gouvernement utilise les lois de programme pour sanctionner les économies à réaliser au détriment des armements conventionnels car il souhaite construire l’arsenal nucléaire sans augmenter l’enveloppe budgétaire des armées ». C’est à la fois, l’occasion d’une proclamation solennelle des orientations politiques et une technique de maîtrise des coûts pour préserver les équilibres budgétaires généraux. La programmation, étendue à l’ensemble des dépenses civiles dans les années 1990, est « un discours politique qui n’engage à rien et l’affichage sans contrainte d’une maîtrise des dépenses publiques ».
Cet ouvrage savant a la force d’un pamphlet comme en témoigne cette remarque : « la loi de programme n’est valable que le jour où elle est votée. Affichage de choix martiaux, elle apparaît comme un palimpseste vain ou, pire, une fable pour crédules ». ■ MLC
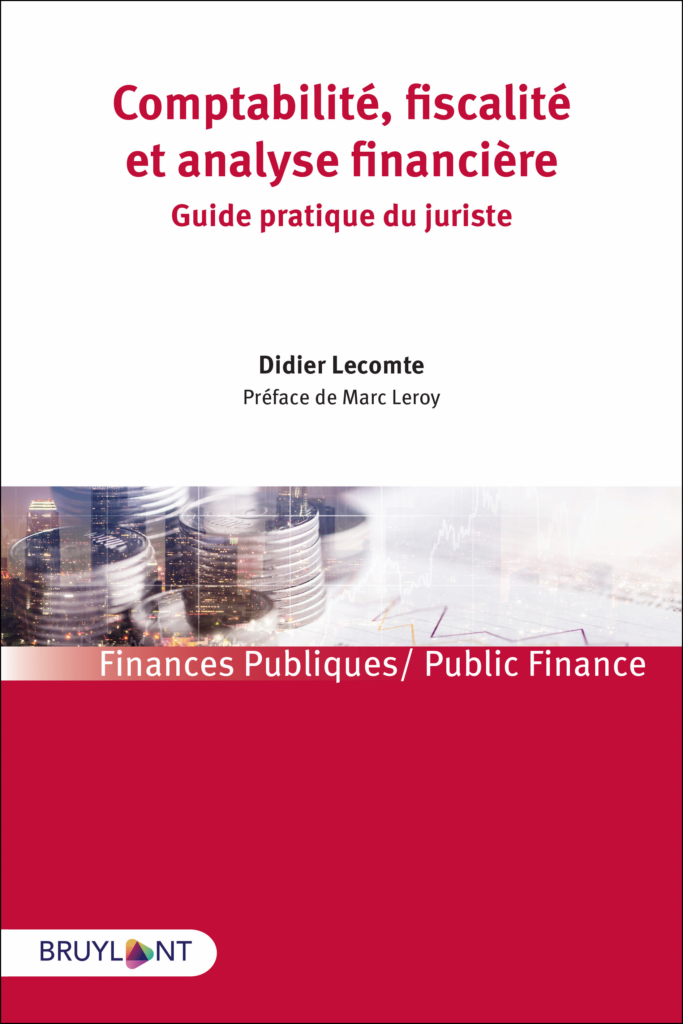
Les finances publiques en questions, Gilbert Orsoni, Bruylant, 2022, 283 pages.
Sous ce titre modeste, Gilbert Orsoni, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille, doyen honoraire de la faculté de droit et de science politique, président d’honneur de la Société française de finances publiques, condense quarante ans de réflexions sur les finances publiques et en tire d’utiles recommandations pour notre temps.
Les finances publiques ont considérablement évolué ces dernières décennies, et plus encore, dans les années récentes : juridicisation renouvelée (notamment sous l’influence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’Homme) ; internationalisation (encadrement budgétaire européen, progrès dans la lutte contre l’optimisation fiscale coordonnés par l’OCDE) ; extension du champ comprenant désormais sans contestation des branches budgétaires, fiscales et monétaires et les domaines sociaux et locaux ; incidence des crises d’hier, d’aujourd’hui et de demain [1] . Or le débat public sur les finances publiques n’est pas à la hauteur de ces enjeux comme l’observe l’auteur : les réformes sont trop souvent improvisées au cours des campagnes électorales (taxation des hauts revenus à 75 % ; allers et retours sur l’ISF ; suppression de la taxe d’habitation) ; le débat fiscal est focalisé sur l’impôt sur le revenu et, dans une moindre mesure, sur l’imposition du capital ; l’idéologie libérale exerce une domination peu discutée ; enfin les finances publiques sont mal aimées : elles inspirent de la méfiance, elles rebutent par leur technicité et leur complexité.
Cependant, cet ouvrage relève le défi d’éclairer les grandes questions relatives aux finances publiques par une réflexion savante mais accessible et d’y apporter des propositions de réponse souvent originales mais toujours réalistes. Le professeur de droit a principalement recours aux techniques juridiques largement complétées par le recours à l’histoire (de l’Antiquité à nos jours en passant notamment par les apports de Gaston Jèze et par les limites du New Public Management), à l’anthropologie, à la sociologie (David Graeber sur la bureaucratie) et à la psychologie (Schmölders et Dubergé). Il prend toujours le temps de définir et de classifier avant d’exposer les points de vue différents et d’amener le fruit, solidement étayé, de sa propre réflexion. Il rejette les idées toutes faites. Il évoque ainsi la révolution « presque » copernicienne de la RCB ; le décalage systématique entre le discours néo-libéral des gouvernants sur la dette publique et la pratique des mêmes gouvernants ; les avancées « limitées » de la LOLF sur les pouvoirs du Parlement ; l’efficacité « assez marginale » de la fiscalité incitative ; l’ambiguïté des termes de réformes ou de révolution (fiscales) « qui peuvent aussi bien s’afficher dans des projets « progressistes » que dans des perspectives ultralibérales »… Il n’oublie jamais les objectifs de l’action publique : lutte contre les inégalités, garantie des droits et libertés fondamentales, bien commun… Selon ses propres termes, il « revisite », parfois même il « déconstruit » mais toujours avec prudence et mesure, et rejetant « les approches superficielles ou partielles, laissant place souvent à l’expression d’a priori dont la dimension polémique voire démagogique n’est pas absente ». Il estime au contraire qu’il est impératif de « croiser et additionner recherches et compétences, de confronter les approches, d’enrichir les perspectives et de conférer toute sa signification au pluralisme épistémologique d’une authentique science des finances ».
Il est impossible de résumer les sept chapitres, denses mais agréables à lire, qui traitent successivement de l’identité des finances publiques, de leurs sources, de leur gouvernance, des fondamentaux et des contraintes, du droit, des contrôles et des choix fiscaux. On peut cependant sélectionner subjectivement quelques aperçus qui inciteront à la lecture approfondie que cet ouvrage mérite.
L’histoire de la conquête de l’autonomie de la discipline des finances publiques, consacrée par les travaux de Gaston Jèze, nous amène à saluer l’apport des caméralistes allemands et le premier traité de finances publiques de Joseph Garnier publié en 1858. Dans les épisodes récents, l’auteur accorde une place importante à l’élargissement et à la globalisation des finances publiques, au nouveau management public dont la LOLF est la traduction « non exempte d’ambiguïtés » et à la juridictionnalisation due à l’action du Conseil constitutionnel et à l’européanisation des finances publiques. L’invitation au retour aux sources des finances publiques apporte une belle étude « historico-anthropologique » sur les origines religieuses de l’impôt avec la théorie de la dette primordiale et une réflexion plus contemporaine sur les liens entre finances publiques et construction étatique. Les réflexions sur la gouvernance des finances publiques et sur les liens entre finances publiques et réforme de l’État l’amènent à souligner les limites des bienfaits de la nouvelle gestion publique (« il serait erroné de croire que le paradigme de la bonne gestion financière et de la recherche de performance de l’action publique ait irréfutablement transformé le management de l’action publique ») et à nous mettre en garde contre le risque d’une bureaucratie d’un type nouveau (« l’explosion de la paperasserie résulte directement de l’introduction des techniques de management des entreprises »). Il expose en détail les théories et les données sur deux points fondamentaux : l’équilibre budgétaire et la dette publique. Le premier est un véritable mythe[2] . L’auteur observe qu’on focalise l’attention sur les prévisions sans considérer suffisamment les données de l’exécution budgétaire. Il conclut sagement à la recherche d’un « authentique équilibre » entre les exigences de sérieux budgétaire et les contraintes de tous ordres et, « s’il faut malgré tout retenir l’idée d’une règle d’or », il donne sa préférence à un budget équilibré en fonctionnement, l’emprunt étant budgétisé et limité au financement des dépenses en capital. Après avoir souligné les diverses spécificités de l’emprunt public, il s’attaque à ’épineuse question de la gestion de la dette actuelle. Il passe en revue les différentes solutions proposées t suggère une dette « perpétuelle », ce qui ne veut pas dire « éternelle », mais renvoie à des emprunts de très longue durée, sans date précise de remboursement du capital, produisant des intérêts et assortis de mécanismes de conversion et de structuration.
La montée en puissance des juridictions nationales et européennes conduit l’auteur à exposer les progrès dans la protection des droits fondamentaux et à s’interroger sur la protection éventuelle des droits créances menacés par les situations de crise et auxquels les citoyens sont légitimement attachés. Le regard sur les contrôles l’amène notamment à étudier les fonctions juridictionnelles et non juridictionnelles de la Cour des comptes. Sur les premières, il rappelle les critiques dont elles font l’objet [3] et se pose « la question de savoir si le type de responsabilité encourue, telle du moins qu’elle se manifeste encore avec le débet, est encore adaptée au contexte actuel ». Sur les secondes, il se demande si la Cour exerce un « pouvoir rédempteur », formule de ses collègues Thierry Lambert et JeanLuc Albert [4] , ou si elle est le « simple poil à gratter du politique ». Son rôle, désormais constitutionnalisé, dans l’évaluation des politiques publiques, lui paraît essentiel. Sur la critique de sa propension à prôner une réduction des dépenses publiques inspirée des méthodes de l’entreprise et des principes de l’orthodoxie budgétaire, il fait observer que « la Cour peut difficilement échapper à « la conception dominante (si l’on ne veut pas utiliser le terme « idéologie ») des phénomènes économiques, financiers et budgétaires ».
Le copieux chapitre sur les choix fiscaux s’ouvre sur des développements substantiels consacrés aux définitions, classifications, nature et fonctions de l’impôt. Sur ce point, la fiscalité incitative laisse Gilbert Orsoni sceptique : « On peut craindre que l’efficacité de ces dispositifs demeure assez marginale hors sensibilisation des citoyens par d’autres moyens ». Il concentre ses critiques sur les dépenses fiscales mais reconnaît qu’il serait irréaliste d’’en supprimer la plus grande partie. Il souhaite donc une meilleure définition, une évaluation plus rigoureuse, une politique de plafonnements des niches fiscales ainsi qu’une simplification du droit commun qui rendrait moins nécessaires ces dispositifs dérogatoires. Son approche de la réforme fiscale est prudente car « tout système fiscal un tant soit peu perfectionné est une association, un agencement des divers types d’impôt et de techniques fiscales. Sa qualité résidant précisément dans l’harmonie globale qui en découle, devant permettre équité et rendement ». Par ailleurs, il reste réticent par rapport à la « grande » réforme fiscale « toujours réclamée, toujours envisagée, jamais réalisée ou n’en restant qu’à ses prémices puisque précisément encore revendiquée ». Il importe de rechercher les conditions d’une meilleure acceptabilité de l’impôt par la pédagogie, par la lutte contre les inégalités, par la simplification et par « un combat plus que jamais déterminé contre l’évitement de l’impôt ». Sur l’impôt sur le revenu et la CSG, il préconise, plutôt que la fusion, une correction de leurs défauts avec un toilettage des dépenses fiscales, le réexamen des quotients conjugal et familial, des ajustements des taux de CSG dans le sens d’un peu de progressivité. De nouvelles contributions sur les revenus et patrimoines les plus élevés, des ménages et des entreprises, lui paraissent indispensables pour lutter contre les inégalités croissantes et faire face aux conséquences des crises. Une révision de la fiscalité locale est nécessaire en recherchant de meilleures assiettes (la valeur vénale), en ne reculant pas devant la poursuite du partage d’impôts nationaux, en instaurant un impôt local prenant en compte les capacités contributives telles qu’un impôt additionnel sur le foncier bâti acquitté par l’occupant du local, propriétaire ou locataire avec des dégrèvements liés au niveau de revenu et à la situation de famille (qui ressemblerait fort à la défunte taxe d’habitation !). Plus original est le souhait de rétablir le lien entre le citoyen et la collectivité par l’élargissement de la participation à l’exercice du « pouvoir local » dans la ligne des budgets participatifs.
Imitant l’auteur, on peut se poser la question de la nature de cet ouvrage : essai ou manuel ? Les deux, évidemment. On peut donc en recommander la lecture aussi bien aux experts des finances publiques qu’aux étudiants, les uns et les autres y trouveront matière à compléter leurs connaissances et à aiguiser leur réflexion. ■ MLC
[1] Les instruments juridiques financiers et les crises, G.Orsoni,GFP n° 1-2022, p.83 à 89.
[2] Les mythes en droit public financier, dossier dirigé par R. Bourrel et A. Rosa, GFP n° 1-2021, p.12 à 104.
[3] La responsabilité des gestionnaires publics : quelles réformes ? M.Le Clainche et F. Gaulier-Camus, GFP n° 3-2020 p. 46 à 53.
[4] Entretien sur l’ouvrage La Cour des comptes, un pouvoir rédempteur ? JL Albert, T.Lambert, GFP n° 1-2018, p. 72 à76
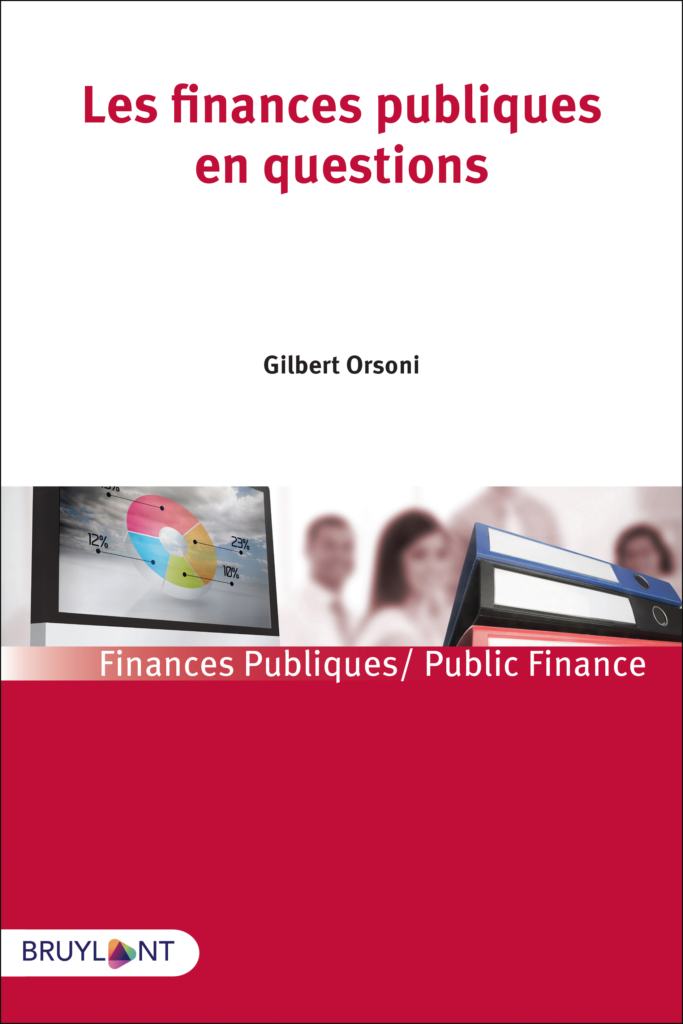
L’auteur est à la fois un praticien, avocat spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés, et un enseignant, maître de conférences associé (HDR) à l’Université CY Paris Cergy. L’universitaire entend mettre en valeur les relations étroites entre le droit, la comptabilité, la fiscalité et, ce qui est plus original dans un seul volume, l’analyse financière. L’avocat souhaite apporter aux juristes les connaissances de base en comptabilité et en analyse financière qui leur permettront de mieux comprendre les entreprises. L’ouvrage vise à surmonter l’ignorance et souvent le dédain des juristes face aux disciplines du chiffre qui sont cependant un élément essentiel du cadre juridique, incompréhensions entretenues par les découpages universitaires et malheureusement transmises aux étudiants. Or, le droit n’est pas une discipline autonome (selon Richard A. Posner, le père de l’analyse économique du droit) alors que la fiscalité et la comptabilité sont des branches du droit par leurs sources, leur mode de raisonnement et leurs applications.
Une introduction historique nous amène aux origines de la fiscalité depuis le tribut et les redevances seigneuriales jusqu’à la fiscalité des entreprises apparue seulement au XXe siècle. La comptabilité en partie double est décrite par Luca Pacioli en 1494, mais elle était connue des Vénitiens dès le XIIe siècle. La normalisation comptable n’apparaît qu’indirectement dans les ordonnances de Colbert en 1673 et ne sera organisée qu’en 1947 dans le cadre des accords de Bretton-Woods. L’analyse financière, qui interprète les documents comptables, apparaît à la fin du XIXe siècle (comme les écoles de commerce) mais le premier ouvrage n’est publié qu’en 1934.
La première partie de l’ouvrage est consacrée à la comptabilité qui est la base de la démonstration. La comptabilité est un système d’informations ayant pour but de décrire les opérations de l’entreprise et d’abord son patrimoine et les variations de celui-ci. L’auteur souligne à juste titre que la comptabilité est bien une discipline juridique encadrée par de nombreux textes issus de sources diverses (de la normalisation internationale (international standard and auditing) et européenne (IFRS) au code de commerce, aux travaux de l’Autorité des normes comptables et au plan comptable général), fondée sur des principes dont certains relèvent du bon sens (sincérité, prudence) et d’autres sont plus techniques (coûts historiques, intangibilité du bilan d’ouverture) et formalisée dans des documents normalisés (le bilan et le compte de résultats qui « dialoguent entre eux », les annexes et les documents de travail). L’ouvrage nous initie à la logique comptable, en particulier les avantages de la comptabilité d’engagement sur la comptabilité de caisse, le fonctionnement de la comptabilité en partie double, la double détermination du résultat par le compte de résultats (recettes- charges) ou par le bilan (variations de l’actif net + variation du passif circulant). Le maniement des comptes est expliqué comme dans un bon manuel de comptabilité sans s’encombrer de détails trop sophistiqués avec des précisions sur la TVA , les comptes de régularisations (charges à payer, provisions, amortissements) et la détermination des résultats par le compte de résultats et par le bilan.
La deuxième partie est consacrée aux usages de la comptabilité par la fiscalité et l’analyse financière. Après un résumé de l’essentiel de la fiscalité française en 30 pages, le passage du résultat comptable au résultat fiscal est précisé. La fiscalité se réfère pour l’essentiel aux règles comptables tout en opérant certains tris entre les charges et entre les produits. Ce qui amène, pour les charges, à des exposés précis sur des notions telles que l’acte anormal de gestion, l’abus de droit, la théorie du bilan et la non-déductibilité des charges somptuaires, des rémunérations excessives, de certains frais financiers ; pour les produits, le régime mère/ fille, le régime de l’intégration fiscale et les exonérations de certaines plus-values, du bénéfice des entreprises nouvelles ou des entreprises implantées en zones franches urbaines.
Puis l’ouvrage aborde les principales notions d’analyse financière, c’est-à-dire la formulation d’un diagnostic sur le patrimoine et les performances de l’entreprise à partir de ses données comptables. Des retraitements sont nécessaires pour passer du bilan comptable au bilan financier qui ne prend en compte que les valeurs nettes, classées selon leur impact chronologique. Ce qui permet de diviser le bilan en trois parties : haut de bilan (actifs et passifs stables), bas de bilan (emplois et ressources cycliques liés à l’activité) et trésorerie (ressources disponibles à très court terme). Divers développements consacrés aux techniques d’analyse financière permettent d’aborder des notions telles que le besoin de fonds de roulement (besoin de liquidités), le fonds de roulement (réserve stable de trésorerie), la marge brute, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, la capacité d’autofinancement. Les ratios financiers (de structure, de suivi du fonds de roulement, de rentabilité et de profitabilité), le calcul du seuil de rentabilité ou point mort, les différentes méthodes de valorisation de l’entreprise sont les principaux produits de l’analyse financière. La sous-partie sur l’impact du droit sur la comptabilité, la fiscalité et l’analyse financière est l’occasion d’exposer certaines opérations complexes, par exemple, le rachat d’entreprise par acquisition de titres (le LBO ou effet de levier), la cession-bail (leaseback), l’affacturage.
Cet ouvrage peut se lire de bout en bout, comme un manuel, ou de manière discontinue, comme une encyclopédie de référence. Bien que destiné par l’auteur prioritairement aux avocats et juristes d’entreprises, il sera aussi utile aux publicistes qui sont en relation avec des entreprises, par exemple pour gérer des organismes chargés de l’exécution d’un service public industriel et commercial (comment financer les investissements), pour calculer plus réalistement des indemnités dues à des entreprises à la suite de cessation temporaire d’activité (en n’indemnisant ni la perte de chiffres d’affaires, ni la perte de bénéfice, mais la perte de chiffre d’affaires diminuée des coûts variables), pour mieux comprendre les difficultés de certaines d’entre elles (qui peuvent provenir d’une insuffisance de trésorerie ou d’un déséquilibre structurel), pour calculer le revenu d’un entrepreneur individuel (d’après ses prélèvements en compte-courant et non d’après les bénéfices de l’entreprise), plus généralement pour diagnostiquer les forces et les faiblesses d’une entreprise. Sans doute, un ouvrage équivalent pour la gestion publique serait tout-à-fait complémentaire et aurait sa place dans la collection « Finances publiques » qui propose déjà l’excellent manuel de Bernard Mattret sur la comptabilité publique. ■ MLC

Cet ouvrage collectif, qui a mobilisé une quinzaine de contributeurs, s’intéresse aux finances publiques sous deux angles particuliers. D’abord, les recherches se focalisent sur l’articulation entre les chiffres privés et les chiffres publics ; ensuite, la démarche s’inscrit dans le temps long qui permet de repérer les continuités et les ruptures. La thèse de l’hybridation des chiffres privés et des chiffres publics est illustrée par de courts articles très abondamment appuyés de références qui montrent la richesse et la vivacité de la recherche historique en matière de finances publiques.
Le principe de séparation des sphères publiques et privées, et donc de leurs chiffres, n’a jamais été absolu. Les données, les comptabilités, les statistiques privées et publiques ont souvent été complémentaires et parfois concurrentes. Cet ouvrage apporte une démonstration convaincante de ces « hybridations et conflits » en analysant savamment les modalités et les enjeux de cette « porosité » entre les chiffres privés et les chiffres publics, du point de vue de leur sources comme de leurs usages au cours de l’histoire.
Celle-ci est présentée en quatre parties, à la fois chronologiques et thématiques : l’Ancien régime où s’opposent la comptabilité marchande impliquant le secret des affaires et les premiers besoins statistiques de l’État ; le XIXe et le premier XXe siècle qui voient l’essor des statistiques publiques à partir de données privées ; la période qui va de l’entre-deux guerres à la fin de la guerre froide, est celle du développement de la publicité des statistiques nationales et leur utilisation par les organisations internationales ; enfin, au cours des XIXe et XXe siècles, s’élèvent des contestations des statistiques publiques et des résistances à la privatisation des normes comptables.
Les chiffres publics étudiés relèvent de la fiscalité, de la comptabilité et des statistiques.
Sous l’Ancien Régime, le roi doit « vivre du sien » mais le financement des guerres et celui de la Maison du Roi sont principalement assurés par les « Messieurs des Finances », chargés de recouvrer l’impôt et qui avancent et prêtent sur leurs deniers personnels. La déclaration des revenus, pour les premiers impôts directs (dixième, vingtième et vingtième d’industrie puis patente), puis à partir de 1917 pour les impôts sur les revenus et sur les bénéfices, est le meilleur exemple de chiffres privés à usage public. Le cadastre a de tous temps permis l’appréciation des valeurs foncières à des fins fiscales, par exemple en Savoie ou dans la généralité de Paris à la fin du XVIIIe siècle.
Les comptabilités commerciales ont été réglementées par les États pour divers motifs, d’intérêt général ou particulier : assurer une bonne information des créanciers puis des actionnaires (ordonnance de commerce, dite code Savary, de 1673), asseoir l’impôt sur les bénéfices à partir de 1917, contrôler les compagnies concessionnaires de chemin de fer, fournir les données nécessaires au pilotage de l’économie… Les plans comptables généraux de 1942, 1947, 1957, 1982 et 1999 s’appliquent à l’ensemble des entreprises. À partir de 1942, l’État règlemente la profession des experts-comptables et installe des organismes de réglementation et de normalisation des comptabilités commerciales.
Les premières enquêtes économiques sont réalisées au XVIIIe siècle par des inspecteurs des manufactures et d’autres acteurs (Intendants, Académies, voyageurs). Au XVIIIe siècle, les chiffres du commerce extérieur et colonial sont centralisés par la Ferme générale, chargée de la perception des impôts indirects, et sont complétés et vérifiés par les chambres de commerce ; les recensements de population coloniale servent à l’administration des territoires. L’ouvrage réserve une place importante aux statistiques, instrument de plus en plus déterminant du moderne « gouvernement par les nombres » [1] . L’essor des chiffres publics commence au début du XIXe siècle. Le premier bureau central de statistique, créé en 1801, est un échec. Le bureau de la Statistique générale de la France sera créé en 1833. Vichy organise la Statistique nationale de la France et ses 18 directions régionales qui préfigurent l’ INSEE créée en 1946. L’Institut assoit son autorité et ne devient le fournisseur principal des chiffres publics qu’après son rattachement au ministère de l’économie et des finances en 1962. L’histoire de la mesure de l’inflation et du pouvoir d’achat dans la deuxième moitié du XXe siècle est riche de « crises et de controverses » : l’indice alternatif de la CGT, l’indice de la grande distribution, le simulateur individuel de l’évolution du prix, les relevés automatiques des données de caisse sont autant de manifestations d’un déclin de la professionnalisation du chiffrage public et d’un recul du collectif. En effet, si ces chiffres ont très souvent une origine privée, le bilan des entreprises par exemple, ils ont été collectés, retraités et complétés de plus en plus scientifiquement et objectivement par des institutions publiques. Ces politiques de l’État pour développer les chiffres publics à partir de sources privées ont toujours rencontré des résistances, notamment au nom du secret des familles et du secret des affaires et, dans les années 1950, de la critique du poids de la charge administrative des entreprises pour répondre aux questionnaires publics. L’extension des attributions de l’INSEE, son souci d’indépendance et d’objectivité, les principes de la loi du 7 juin 1951 ont peu à peu instauré une confiance solide dans le dispositif d’élaboration des chiffres publics. La résistance des multinationales à la publication de statistiques de leur activité pays par pays, en définitive imposée dans le cadre du projet BEPS de l’OCDE, est une nouvelle manifestation des réticences du secteur privé à participer à l’effort de transparence dans l’intérêt général.
D’autres études appuient la démonstration : la création de la centrale des risques bancaires par Vichy aux fins de contrôle du crédit ; l’histoire de l’indice des prix en Argentine depuis 1918, alternant pilotage de l’économie et crises de confiance, l’harmonisation (un peu artificielle) des statistiques du travail par le BIT, l’échec du projet de chiffrage socialiste qui n’a pas résisté à l’ouverture de l’économie des pays du bloc socialiste.
Mais, désormais, l’âge d’or des chiffres publics serait passé. Plusieurs contributions alertent sur le danger d’une nouvelle privatisation des données publiques, construites en négociation avec les représentants du secteur productif, normalisées à la sauce américaine par des organismes à la légitimité douteuse et faiblement contrés par l’Union européenne, et bientôt produites automatiquement par des dispositifs privés. On peut même observer une inversion des rapports entre les sphères publiques et privées, par exemple dans le développement de l’usage d’outils comptables privés pour mieux gérer les finances publiques. La comptabilité en partie double, inventée en Italie au XIIIe siècle, a été adoptée progressivement par les administrations publiques : expérimentation des frères Paris entre 1716 et 1726, puis premières applications sous l’impulsion de Mollien sous l’Empire, développement très progressif au cours du XXe siècle. Une comptabilité inspirée partiellement de la comptabilité commerciale a été adoptée successivement par les compagnies de chemins de fer, les offices, les EPIC et les budgets annexes, puis par les hôpitaux, les HLM, les comptes de commerce. Le décret de 1962 transpose la nomenclature du PCG aux comptes de l’État. La LOLF consacre dans son article 30 le principe d’un alignement, sauf exception justifiée, des comptabilités publiques sur les règles du secteur privé et instaure la comptabilité patrimoniale de l’État. Les études coûts et efficacité apparues d’abord dans l’industrie textile vont se répandre dans les chemins de fer et les armées avant de trouver de nouvelles applications sous l’impulsion du Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, puis du 3PB militaire et de la RCB.
Plusieurs auteurs s’alarment du fait qu’au moment où s’instaure une société mondialisée du chiffre et des données massives, les rapprochements conceptuels, les convergences et les productions directes de chiffres publics par des organismes privés marquent la victoire du marché et le recul de l’autorité publique. Pour ces auteurs, la privatisation des chiffres publics caractérise une perte de l’indépendance de l’État et de sa capacité à imposer des règles d’intérêt général.
Derrière les chiffres publics se jouent en effet les rapports de la société et de son État. Cette réflexion transversale présente tout l’intérêt de ce livre. Même l’observateur qui ne partage pas complètement la vison pessimiste des coordonnateurs de l’ouvrage, reconnaîtra que nous sommes entrés dans l’ère des « chiffres hybrides ». ■ MLC
[1] Desrosières Alain, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, La Découverte, 1993 ; id . Prouver et gouverner, Une analyse politique des statistiques publiques, La Découverte, 2014 ; Supiot Alain, Le gouvernement par les nombres, Fayard, 2015. Pariente Alain (dir.), Les chiffres en finances publiques, Mare & Martin, 2019.


